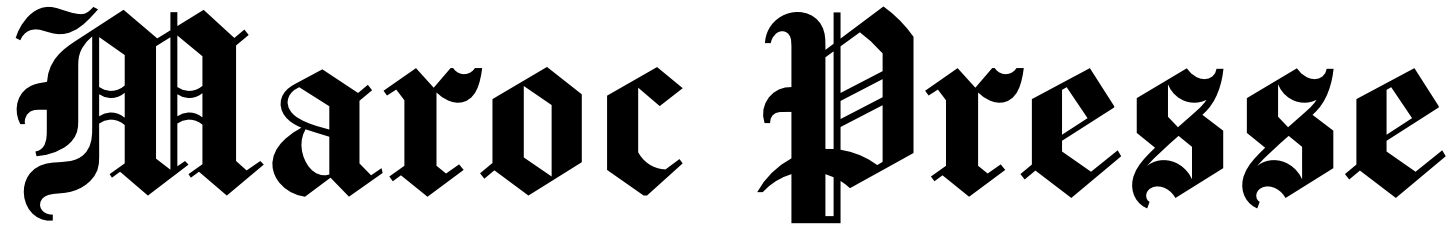mères célibataires, condamnées avant même d’accoucher
“Au Maroc, tout le monde vous regarde étrangement quand vous savez que vous êtes une mère célibataire”, explique Zineb (nom supposé), une mère de 19 ans, avec le journal El Pais. La jeune femme, qui a accouché il y a un peu plus d’un mois, vit avec son bébé dans le centre de réception de l’Institut national de solidarité féminine (INSAF) à Casablanca. Le centre accueille actuellement une vingtaine d’enfants orphelins de père et leurs mères ont nié par leur famille.
Dans le cadre de la réforme du code de la famille, les féministes demandent de reconnaître l’enfant d’une mère célibataire le droit de porter le nom de son père, de bénéficier de la pension alimentaire et de revendiquer l’héritage. Consulté sur la question du roi Mohammed VI, le Conseil des Ulemas, la plus haute autorité religieuse, a déclaré que les tests d’ADN visant à déterminer la paternité sont “contraires à la charia (loi islamique)”.
Lire: Maroc: la “réalité amère” des mères célibataires
«En 25 ans d’existence, nous avons accueilli environ 15 000 femmes. Aujourd’hui, nous accueillons mille mille par an, mais nous avons besoin de beaucoup plus de soutien social », explique Amina Khalid, 58 ans, secrétaire général de l’INSAF. L’institut s’occupe de la mère avant l’accouchement pendant au moins six mois et couvre les dépenses de l’enfant pendant deux ans, tout en continuant à suivre l’enfant par la suite, ajoute Saadi El Allawi, 26 ans, directeur du développement social à l’INSAF.
Pour Khalid, “être une mère célibataire au Maroc est à condamner à une vie de discrimination”. Ne pas accepter les tests d’ADN comme preuve de paternité est une violation de la constitution marocaine qui oblige l’État à garantir “la protection juridique et la considération sociale égale à tous les enfants, quelle que soit leur situation familiale”, affirme pour sa part Nezha Skali, 73 ans, ancien ministre de La famille (2007 à 2011). Pour sa part, le Conseil économique et social (CESE) a expressément appelé à la reconnaissance du droit aux tests ADN comme “un élément scientifique de détermination de la paternité”.