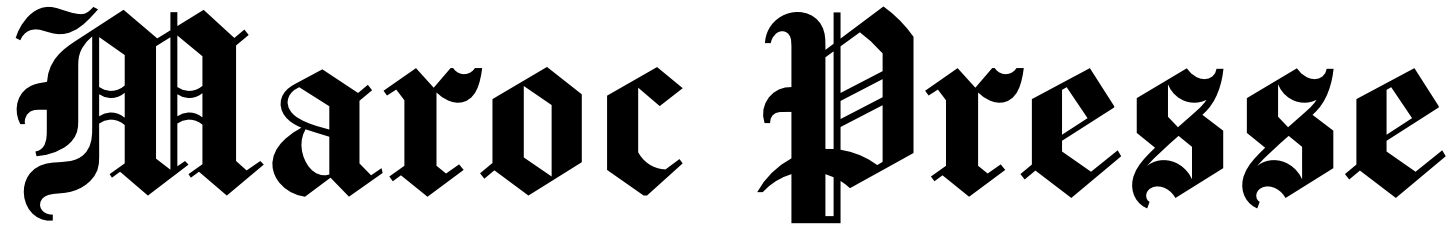Représentations inversées: piège parfait du Zimbabwe, danger imminent de l’Afrique du Sud | Actualités de la dette
Le 7 février, la Maison Blanche a réduit l’aide à l’Afrique du Sud, citant une menace inexistante pour les agriculteurs blancs de l’expropriation des terres gouvernementales. Pour voir ce qui pourrait se situer au-delà du décret de Trump, l’Afrique du Sud n’a besoin que de regarder vers le nord. L’économie du Zimbabwe a été écrasée par des sanctions imposées après la redistribution des terres agricoles de l’ère coloniale. Et malgré les efforts pour apaiser l’établissement de développement, il semble que Washington préfère le pays à suspendre, comme un cadavre dans un gibbet, de peur que les autres pays commencent à obtenir leurs propres idées.
En juillet 2020, dans les dents de la pandémie Covid-19, le Zimbabwe a accepté de verser 3,5 milliards de dollars en compensation à environ 4 000 propriétaires fonciers blancs pour les biens redistribués lors des réformes agraires. Cette somme, cinq fois la taille du plan de relance à la stimulation de mai 2020 du Zimbabwe, a été engagée à un moment où les Nations Unies ont averti que le pays était «au bord de la famine artificielle». L’accord est intervenu après des années de pression, les responsables zimbabwéens espérant que cela persuaderait les États-Unis de soulever la Punitive 2001 Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act (Zdera) qui a bloqué l’accès du pays aux prêts et l’aide internationale pendant deux décennies. Pourtant, le Zimbabwe n’avait pas les fonds à payer et Zdera est resté.
Le récit conventionnel dépeint la réforme agraire du Zimbabwe comme une expropriation téméraire par le despotique Robert Mugabe, conduisant à un effondrement économique. Cette version réécrit l’histoire. Pendant la colonisation britannique, il était interdit aux Africains de posséder des terres en dehors des «réserves indigènes». Au milieu du 20e siècle, 48 000 colons blancs ont contrôlé 50 millions d’acres (plus de 20 millions d’hectares) de terres agricoles privilégiées, tandis que près d’un million d’Africains ont été confinés à 20 millions d’acres de terres largement infertiles – une injustice qui a alimenté la lutte de libération du Zimbabwe.
L’accord de la Chambre Lancaster de 1979, qui a mis fin à la règle des minorités blanches, a restreint la réforme agraire aux transactions de marché pendant une décennie, garantissant que la propriété foncière de l’ère coloniale a persisté. Malgré cette contrainte, le Zimbabwe a fait des progrès dans le développement humain dans les années 80. Mais à la fin de la décennie, la Banque mondiale et le FMI ont imposé un programme d’ajustement structurel économique, la réduction des dépenses publiques, la suppression des subventions et la privatisation des entreprises de l’État. Le résultat: le chômage de masse, les services dégradés et l’approfondissement de la pauvreté.
En 2000, face à une pression intérieure croissante, le gouvernement de Mugabe a commencé la redistribution obligatoire des terres. Le programme avait des défauts – un soutien inadéquat pour les nouveaux agriculteurs et des ressources insuffisantes pour reconstruire des chaînes d’approvisionnement agricoles. Pourtant, contrairement aux récits de catastrophe, des milliers de Zimbabwéens sans terre ont profité tandis qu’une petite élite de colons blancs a perdu leur statut privilégié.
La réponse internationale a été rapide et punitive. Lorsque le Congrès américain a adopté Zdera en décembre 2001, il a été explicitement présenté comme une réponse au programme de réforme agraire du Zimbabwe, encadrant les actions du Zimbabwe comme une menace pour la politique étrangère des États-Unis. Le Royaume-Uni, l’Union européenne, l’Australie et le Canada ont suivi avec leurs propres mesures punitives. Pendant deux décennies, le Zimbabwe a été piégé dans un cycle d’isolement économique, incapable d’accéder aux prêts et à l’investissement nécessaires pour reconstruire.
Le coût humain a été stupéfiant. Les experts des droits de l’homme de l’ONU ont averti à plusieurs reprises que Zdera a eu un «effet d’entraînement insidieux» sur l’économie du Zimbabwe et la jouissance des droits fondamentaux. La communauté du développement de l’Afrique australe estime que le Zimbabwe a perdu accès à plus de 100 milliards de dollars de soutien international depuis 2001.
L’accord d’indemnisation de 2020 est une ironie cruelle. Le Zimbabwe, déjà en faillite, doit maintenant emprunter des milliards pour payer les anciens bénéficiaires coloniaux, dans l’espoir d’échapper à une loi punitive imposée en réponse à son programme de réforme agraire. Cela crée un piège parfait: une nation forcée de financer sa subjugation, tandis que son peuple souffre.
L’absurdité est soulignée par le refus des États-Unis de soutenir la restructuration de la dette du Zimbabwe par le biais de la Banque africaine de développement. Les responsables américains insistent sur le fait que Zdera est «une loi, pas une sanction», mais c’est une distinction sans différence – que ce soit par des sanctions formelles ou une législation, l’objectif reste le même: protéger les droits de propriété des colons sur la justice pour les colonisés.
Ce n’est pas seulement l’histoire du Zimbabwe. L’administration Trump a récemment attaqué les efforts de réforme agraire de l’Afrique du Sud, affirmant à tort que le gouvernement «saisissait les terres des agriculteurs blancs». Cette rhétorique, amplifiée par des médias d’extrême droite, ignore que la réforme agraire de l’Afrique du Sud – un processus mandaté par la Constitution – cherche à corriger la dépossession de l’ère de l’apartheid, où les Sud-Africains blancs, 8% de la population, contrôlent 72% des terres agricoles.
L’intervention de Trump ne concernait jamais les droits de propriété – il s’agissait de préserver un système mondial qui favorise les anciens colonisateurs sur la dépossédé. La lutte pour la justice terrestre au Zimbabwe, en Afrique du Sud, et à travers le Sud mondial n’est pas seulement une lutte locale – elle est mondiale.
Comme Thomas Sankara, le chef révolutionnaire du Burkina Faso, l’a dit un jour, la dette est «une reconquête intelligemment gérée de l’Afrique». Le sort du Zimbabwe est un rappel brutal de cette vérité. La communauté internationale doit compter avec l’héritage du colonialisme et les systèmes qui continuent de l’appliquer. Jusqu’à ce que nous le fassions, la promesse de libération restera hors de portée de millions.
La réforme agraire du Zimbabwe n’était pas parfaite, mais c’était nécessaire. La tragédie n’est pas la réforme elle-même, mais le contrecoup mondial punissant le Zimbabwe pour avoir osé défier le statu quo. Il est temps de lever les sanctions, d’annuler les dettes et de permettre au Zimbabwe, en Afrique du Sud et à d’autres nations de poursuivre la justice à leurs propres conditions. La réforme agraire n’est pas une menace – c’est une demande de justice, une que le monde ne peut plus ignorer.
Les opinions exprimées dans cet article sont les propres auteurs et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.